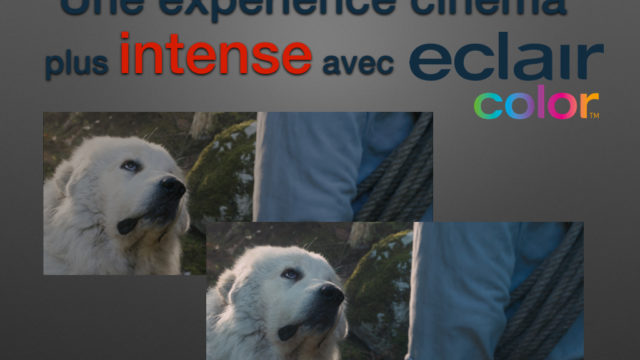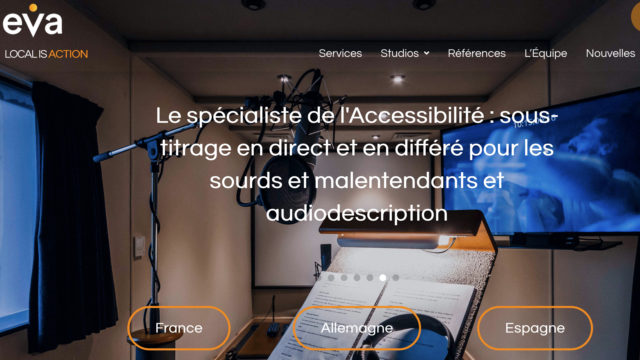Le format du DCP
Un DCP est un dossier qui contient plusieurs fichiers : les médias image et son, les sous-titres, une ou plusieurs listes de lecture (CPL) et des fichiers de service (VOLINDEX, ASSETMAP, PKL).
Quand il existe plusieurs versions d’un film (VO, VF, 5.1, 7.1, Atmos…), on peut mettre chaque version dans un DCP séparé, mais on peut aussi les réunir dans le même. Dans ce cas, pour la VO une CPL lira l’image originale, le son original, et les sous-titres français ; pour la VF, une autre CPL lira l’image originale et le son doublé. Cela permet de réduire le volume à envoyer puisque dans cet exemple on n’envoie l’image qu’une fois.
Il est également possible de créer un DCP principal (OV) et de mettre les autres versions dans un DCP additionnel (VF). Les CPL de ce DCP additionnel feront aussi appel aux fichiers du DCP principal. Évidemment, c’est un peu plus délicat à gérer par le cinéma, car si par erreur on supprime le DCP principal, l’additionnel devient inopérant.
Le format du DCP a été défini en 2005 par le DCI sous le nom de « Interop », et a été adapté lorsque les instances de standardisation ont repris le flambeau. Depuis, la SMPTE a proposé un nouveau format qui prend notamment en charge de nouvelles cadences : en plus des 24 et 48 i/s présents dans l’Interop, il intègre le 16, 18, 20, 22, 25, 30, 50, et 60 i/s (HFR). Aujourd’hui, ces deux formats coexistent, car tous les lecteurs dans les salles de cinéma ne sont pas encore à jour, et certains ne peuvent lire que l’Interop.
Pour savoir si un DCP est Interop ou SMPTE, il suffit de regarder son répertoire : si les fichiers VOLINDEX et ASSETMAP ont l’extension XML, il s’agit d’un DCP SMPTE ; sinon, c’est un Interop.
Enfin, si le transport se fait par disque dur, se pose le problème de son formatage. L’ISDCF préconise l’usage de l’EXT3, le système de fichiers Linux, et accepte aussi maintenant l’EXT2. Rien n’empêche d’utiliser un formatage Windows, mais plusieurs types de lecteurs ne sont pas compatibles, tandis que tous le sont avec l’EXT3.
Les étapes
La fabrication d’une copie numérique passe par plusieurs étapes :
– le DSM, c’est-à-dire le master numérique finalisé, monté, étalonné, mixé ;
– le DCDM, un élément intermédiaire qui formate les médias et prépare le DCP ;
– et le DCP, la copie d’exploitation.
Le DSM est du ressort de la postproduction, qui a toute liberté pour utiliser les formats de son choix.
Pour créer le DCDM, on va passer la résolution de l’image, quelle qu’ait été celle utilisée pendant la postproduction, en 2K ou en 4K, et en 12 bits linéaire, souvent en l’encapsulant dans des séquences d’images DPX ou TIFF. De plus, l’image passera d’un espace RVB en XYZ, avec un Gamma de 2,6. La cadence normale est de 24 i/s, mais il y a des exceptions : parfois, le client apporte une cassette HDCam ou un fichier ProRes.
Le son – il peut y avoir plusieurs versions s’il y a plusieurs langues – doit être en 48 ou 96 kHz, en 24 bits.
Ce n’est pas indispensable, mais le plus souvent un long-métrage est découpé en « bobines » d’une vingtaine de minutes, pour l’image comme pour le son, héritage du 35 mm conservé en numérique, car cela produit des fichiers plus faciles à manipuler et à adapter.
Il existe trois façons de gérer les sous-titres : soit les mettre dans un fichier XML, accompagnés de leur police, soit dans des fichiers PNG, soit directement dans l’image. Dans les deux premières solutions, le lecteur ou le projecteur se chargent de les incruster à l’écran. La première solution est la plus courante, mais pour des bandes-annonces, dont la projection risque d’être moins soignée, on préfère souvent les incruster directement en laboratoire. Pour les sous-titres n’utilisant pas l’alphabet latin (chinois, arabes…), on utilise le PNG : l’Interop crée un fichier par sous-titre, et le DCP contiendra donc un millier de fichiers, tandis que le SMPTE encapsule tous les sous-titres dans un seul MXF.
La fabrication du DCP
Une fois tous ces éléments prêts, commence la fabrication du DCP à proprement parler. L’image est compressée en JPEG 2000 en VBR à 250 Mb/s : si l’on est en 2K, ce débit est suffisant et même pas toujours atteint, tandis qu’en 4K il faut parfois optimiser l’encodage, et il est possible de le dépasser transitoirement ; en relief, on décime souvent l’image en 4:2:2 pour réduire son poids. Cette limite, imposée par le débit des lecteurs, est remise en cause aujourd’hui et serait portée à 450 ou 500 Mb/s pour soutenir les cadences HFR. Puis l’image est cryptée et encapsulée en MXF.
Le son n’est plus modifié puisqu’il est livré à la salle non compressé, il est seulement encapsulé en MXF.
Le nom de la CPL, qui donne au projectionniste différentes informations sur le film (titre, ratio, langue, son, relief…), est défini par celui qui crée le DCP. L’ISDCF propose une convention de nommage qui permet de les uniformiser, mais qui évolue (actuellement la version 9), donc le nom d’une ancienne CPL n’aura pas le même aspect que celui d’une récente.
Enfin, on fabrique les KDM spécifiques à une CPL, un lecteur, et une plage de temps déterminée, en utilisant le certificat de son lecteur. Si un DCP contient plusieurs CPL, il faudra autant de KDM, si toutefois le distributeur veut y laisser accès.
Chez Ymagis
Ymagis utilise soit un Doremi Rapid, pas l’outil le moins cher (environ 40 000Ä lors de son achat), mais le plus pointu, celui qui permet de faire le paramétrage le plus fin, soit un Clipster DVS (Rhode & Schwarz) qui est plus polyvalent : alors qu’un Doremi demande un vrai DCDM, le Clipster, qui, à l’origine, est un outil vidéo, acceptera d’autres sources, un ProRes par exemple. Mais un Doremi permet un travail plus fin. Si, dans une bobine, il se trouve une image verte, on peut la remplacer directement dans le fichier. Le Doremi gère les DCP multiversions et facilite la gestion des KDM. On trouve dans le laboratoire aussi un easyDCP, mais il ne sert que lorsqu’on a besoin de « jeter un coup d’œil » préalable à un DCP.
Jérémy Boisseau, responsable laboratoire, utilise la fonctionnalité qui permet de mettre plusieurs CPL dans un même DCP afin de diminuer le poids des fichiers à expédier et le temps de l’acquisition dans les lecteurs. En revanche, il dissuade ses clients d’utiliser les DCP additionnels qu’il considère source d’erreurs.
Pour le format, il continue de préférer l’Interop, considérant que le format SMPTE n’est pas encore véritablement fini et la perspective de son futur pas encore bien nette. Il ne semble pas que tous les lecteurs qui supportent le SMPTE en acceptent toutes les nouvelles cadences, donc quand on lui soumet un film en 25 i/s, il préfère proposer une conversion en 24 i/s. Mais, dans le cas d’un son Atmos, le SMPTE est le seul format compatible.
Les vérifications se font dans les deux salles, équipées d’un lecteur Doremi et un projecteur Christie, l’une en 2K, l’autre en 4K.
Mais Ymagis, qui a repris une partie de l’activité de SmartJog pour développer son activité de transport dématérialisé et vient tout récemment de créer « SmartJog-Ymagis Logistics », se charge aussi de transporter des DCP qui viennent de l’étranger et qu’ils n’ont pas forcément encodés. Néanmoins, la société propose toujours à ses clients un travail d’adaptation au marché local. Disney, par exemple, envoie jusqu’à huit versions, dont ils retiennent les éléments nécessaires et qu’ils fusionnent en un seul DCP, avec plusieurs CPL.
Dans le débat sur la fabrication « en cuisine », Jérémy Boisseau met en avant l’expérience terrain d’Ymagis qui est aussi un installateur de salles, dont les problèmes sont remontés à la partie laboratoire.
Éclair
Éclair Group a commencé la fabrication de DCP en 2005, c’est-à-dire dès l’origine du DCI, et a même été le premier en Europe à faire du 4K. Ils travaillent également avec le Doremi Rapid, qui leur fait la compression et l’encapsulage, et sur lequel ils ont ajouté des développements maison, en particulier pour automatiser le travail : au début, la création d’un DCP pouvait prendre une semaine, aujourd’hui elle se fait en un jour.
La compression en JPEG 2000 ne pose pas de problème, c’est aujourd’hui bien maîtrisé. Quand le film est en 24 i/s, on produit un Interop, on utilise le SMPTE uniquement pour le 25 i/s ; pour le 16 i/s, on préfère passer en 48 i/s (qui est un multiple de 3). Ici on utilise les DCP principaux et additionnels et l’on donne toutes les versions aux salles, on considère que les projectionnistes savent aujourd’hui les gérer, les distributeurs faisant parvenir seulement les KDM correspondant au contrat passé avec la salle. Les noms de CPL sont générés par leur propre outil logiciel, en suivant les préconisations de l’ISDCF.
Chaque master DCP est systématiquement chargé dans un lecteur et projeté en situation réelle, la vérification étant l’une des plus grosses parties du travail. Frantz Delbecque, directeur R&D et Nouvelles Technologies, ne fait confiance qu’à la salle : ce n’est pas parce qu’un logiciel lit le DCP qu’il sera forcément lu sur un couple lecteur-projecteur, d’autant qu’avec la migration du bloc de sécurité et des disques dans le projecteur (IMB, IMS), un DCP peut rencontrer des configurations passablement différentes. Il n’est pas rare que, dans une salle où tout marchait bien, après une mise à jour logicielle les sous-titres disparaissent par exemple… À tel point qu’on les incruste parfois dans l’image afin de garantir leur affichage.
Cannes est un bon exemple de tous les problèmes possibles et imaginables que l’on peut rencontrer. Éclair y avait installé en 2013 un atelier de mastering et de « réparation » pour répondre à toutes les difficultés : blocage au moment de l’acquisition, nom de fichier avec des espaces, débit d’image trop élevé, erreurs d’encapsulage, XML mal formé avec une balise vide, sous-titres incompatibles ou désynchronisés… la liste est variée. Ils ont même vu arriver un fichier sortant d’un iPad !
Éclair gère la distribution des DCP de manière physique ou dématérialisée. S’il s’agit d’un disque dur ordinaire, il est envoyé par Chronopost avec une enveloppe retour : parti du laboratoire à 17 heures, il sera à la salle le lendemain à 13 heures. Ils utilisent soit des disques USB classiques soit des disques CRU plus résistants mais beaucoup plus volumineux, car ils sont envoyés avec leur châssis, toutes les salles n’étant pas équipées. Les bandes-annonces circulent encore souvent sur un simple DVD-ROM ou sur une clé USB.
En ADSL, le film peut partir par tous les prestataires (SmartJog, Globecast…), mais aussi par le service maison qui vient d’être développé avec Deluxe. Le délai est plus long que par courrier, il faut compter entre 24 et 36 heures de transfert, d’où l’intérêt des DCP regroupant plusieurs versions. Compte tenu du week-end, il faut souvent déclencher l’envoi le vendredi pour une projection le mercredi. Or, selon l’idée reçue qu’avec le numérique ça va plus vite, le laboratoire reçoit les éléments de plus en plus tard, et travaille souvent dans l’urgence.
Les distributeurs peuvent utiliser le portail Web d’Éclair pour générer leurs KDM, ou utiliser leur propre application qui s’y interface. Ce n’est pas une activité anecdotique, elle emploie deux personnes à plein temps : sur 2013, quelques 500 000 clés ont ainsi été générées.
Color’M
Il y a les gros laboratoires, mais il y a aussi ceux de taille plus modeste. Éric Moulin a associé le destin de Color’M à celui d’Alchimix (à Paris dans le XIe arrondissement) pour développer son activité d’étalonnage de rushes vidéo et cinéma (fourniture de DNxHD 36), d’étalonnage final, et de production de DCP master (il ne fait pas de série). Il dispose de deux salles : une avec un Doremi, un Christie 2K, et un Scratch ; l’autre avec un vidéoprojecteur HD et un DaVinci Resolve pour la télévision.
Il jongle avec deux outils, easyDCP Creator de Fraunhofer et Mist de Marquise Technologies. Il fut en France le premier utilisateur de Mist qui lui sert d’abord à traiter des rushes (étalonnage primaire et application de LUT).
Il fait le JPEG 2000 sur l’un ou l’autre des systèmes. EasyDCP le fait très bien, mais Mist encore mieux. La différence néanmoins est à peu près indiscernable sur une image, mais on s’en rend compte sur des mires.
Quand il s’agit de 24 i/s, il n’a pas de problème de compatibilité avec les différents lecteurs. Mais pour des films tournés et diffusés à 25 i/s, il arrive que les sous-titres ne soient pas lus par certains lecteurs, comme ceux de Dolby. Il préfère dans ce cas les incruster dans l’image.
En général, les sous-titres sont souvent source de problèmes. S’ils viennent d’une société professionnelle (Titra, CMC), tout va bien ; s’ils viennent de chaînes de télévision ou, pire, s’ils ont été conçus « dans la cuisine », ils s’avèrent souvent inexploitables.
Highfun
Chez Highfun (également dans le XIe), Thibaud Caquot dispose de deux Scratch, l’un pour l’étalonnage, l’autre destiné à diverses prestations techniques, avec lesquels il finalise des documentaires, des longs et des courts-métrages pour des productions indépendantes. Les documentaires réclament souvent un ProRes 4:4:4 mais, pour le cinéma, il utilise Scratch ou easyDCP pour compresser en JPEG 2000. C’est un peu plus long sur Scratch, sans doute de meilleure qualité, mais il reconnaît qu’il est difficile de voir la différence.
Le cryptage – qui n’est pas toujours demandé, les productions indépendantes n’ayant pas la même attitude vis-à-vis du piratage – se fait toujours sur easyDCP dont l’interface est très simple : il suffit de glisser dans des boîtes les médias et de se laisser guider. EasyDCP fait automatiquement les vérifications, comme des longueurs de l’image et du son qui doivent être parfaitement identiques. En particulier, il gère le nom de la CPL qui, quand elle est créée manuellement, comme sur des logiciels gratuits, peut être une source d’erreurs.
Quant au débat sur le format du DCP, ici aussi on préfère en rester au Plus Petit Dénominateur Commun, c’est-à-dire l’Interop, en particulier quand le dossier part pour un festival ou dans des petites salles dont les lecteurs n’ont pas été forcément mise à jour. Il ne produit de SMPTE que s’il connaît la salle où sera projeté le film.
Pour les films en 25 i/s, qu’il confirme être une source d’incompatibilité, ici aussi on incite « très fortement » le client à les convertir en 24 i/s : on préfère le voir partir que revenir insatisfait. On reste une image pour une image, on ralentit donc légèrement le film de 4 % et l’on allonge sa durée. Puis on ralentit le son avec harmonisation. Cela se passe bien en général, seuls les films musicaux peuvent être délicats, à moins qu’on ne dispose des stems (pistes de prémixage : voix, musique, effets…), ce qui permet d’ajuster l’harmonisation finement. Grâce au 24 i/s, les sous-titres ne posent plus de problèmes et peuvent rester en XML.
Alors, et les cuisines ?
Pour ceux qui n’ont d’autre choix que le « home made », on trouvera ci-contre une liste (non exhaustive) de solutions, dont les gratuites.
Évidemment, on ne déniera pas aux laboratoires l’avantage essentiel qu’est une garantie de bonne fin. Il n’est certes pas impossible de fabriquer un DCP soi-même, mais on s’expose à quelques déboires. Les logiciels gratuits bénéficient de moins de ressources pour leur évolution et le débogage, tandis qu’un laboratoire qui a acheté un outil cher, s’il rencontre une difficulté, fera pression sur le fabricant pour la résoudre rapidement.
Au final, le minimum consiste à relire le DCP sur un vrai projecteur en salle, avant les projections publiques.