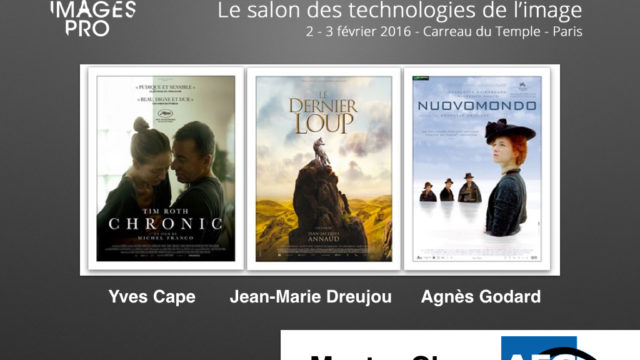« Deux films majeurs m’ont donné envie de faire du cinéma, ce sont Le massacre de fort Apache (1948) et La charge héroïque (1949) de John Ford. Quand je les ai vus, j’ai adoré ces grands espaces, ces ciels immenses de Ford avec ces nuages. Mais ce qui me touchait, j’avais 13 ans, c’était ces scènes de bals, d’anniversaires, de célébrations, de rituels de la communauté. Était-ce parce que j’étais coupé du monde en étant pensionnaire dans un collège ? Était-ce une réaction contre cela qui m’attirait naturellement ? Ce qui m’a mené chez Ford, ce n’est pas seulement son esthétique, mais ce goût pour son univers collectif.
« Il y a là un côté paradoxal. J’ai été un grand défenseur du cinéma américain, et en tant que cinéaste, avais des principes idéologiques qui étaient le contraire d’une grande partie de ce cinéma, qui a fait primer l’individualisme, le héros solitaire. Ford est un peu une exception, mais il y en a d’autres ! D’une certaine manière cela guidait mes choix esthétiques.
« Je me souviens d’une discussion avec le cadreur du film La vie et rien d’autre, Alain Choquart. Je lui avais montré La charge héroïque et lui avais fait remarquer que John Wayne était très rarement seul dans le plan ; il est toujours cadré au milieu des hommes, jamais isolé, cadré comme quelqu’un qui va être le sauveur du groupe. L’appui que vont lui donner ces hommes est important.
« Je lui ai dit qu’il faut qu’on adopte exactement la même chose avec Noiret dans La vie et rien d’autre. Même s’il est dans une seule pièce on va chercher une fenêtre où on fera passer des gens. Quand on est dehors, il faudra toujours qu’il soit au milieu de la collectivité, au milieu d’un groupe. Là, c’est un principe fondamental. Je ne crois pas au héros qui va tout bouleverser, tout gagner. J’ai un intérêt pour le groupe plutôt que pour le héros solitaire.»
Les débuts
La famille a beaucoup compté pour moi. L’horloger de Saint-Paul (1973) est un film sur les relations père-fils, mais c’est aussi un film sur Lyon, ma ville natale. Je n’y ai mis que des lieux qui étaient ceux de mon enfance, c’est une manière pour moi de retrouver des repères. J’avais cela dans la tête et je marchais sur des terrains que je connaissais un peu.
« Quant à la diversité, c’est vrai que les premières choses qu’on me demande c’est : « Pourquoi changez-vous perpétuellement de genre ? » Il y a plusieurs réponses, c’est d’abord parce que j’ai envie de m’épater moi-même. J’ai envie à chaque film de me donner de nouveaux défis, de ne pas tomber dans la routine. Si j’ai fait un film dans un genre précis, il faut que le suivant soit très différent. Cela m’oblige à chercher et je pourrais répondre, comme Mickael Powell, qui disait : « Tous les films que j’ai faits je les ai faits pour apprendre ». Il ne peut pas y avoir de plus grand compliment pour un metteur en scène que de sentir que tout le monde comprend ce que vous faites.
« Ce qui a été le cas dans Le capitaine Conan. J’avais essayé de retrouver ce qui se passait dans la tête des gens quand ils participaient à cette bataille et on a tourné. Or, il s’est passé un accident. Le comédien qui devait s’arrêter, au lieu de marcher, s’est mis à courir en entraînant ses hommes. Les hommes ont suivi, mon chef opérateur a suivi. J’ai vu mon assistant faire un signe qui a lancé les cavaliers et les soldats. Et, à ce moment là, vous avez une sorte d’euphorie parce que vous avez l’impression que tous les gens autour de vous font le même film que vous ! »
Une immense curiosité
« Mes goûts ne sont pas exclusifs, mais moi, metteur en scène, j’ai toujours eu une immense curiosité, qui fait que je passe, à quelques mois de distance, de l’univers des anciens d’Algérie dans La guerre sans nom, au policier de L627 alors que juste avant je sortais de La vie et rien d’autre ; donc je passais de la guerre de 14 à la guerre d’Algérie, avec un détour par les flics, par les stups, dans un film complètement contemporain.
« Passer de Dans la brume électrique sur la Louisiane du sud à La princesse de Montpensier et ensuite à Quai d’Orsay, cela demande une sorte d’agilité mentale et de capacité à absorber des mondes différents en ayant toujours des commentaires prodigieusement élogieux de la part des gens qui sont concernés et qui connaissent ces mondes.
« Recevoir de Tommy Lee Jones un mot me disant : « Votre film a su capturer l’essence de la Louisiane du Sud », sachant que pour lui, il ne peut pas y avoir de plus grand compliment puisqu’il pense qu’aucun cinéaste américain n’arrive jamais à comprendre le Sud, ni même Hollywood.
« John Woodman avait dit la même chose : « Voilà le premier film qui montre ce qu’est la Louisiane ». Ensuite, je tombe dans le XVIe siècle avec La princesse de Montpensier, et là, de nombreux historiens viennent me dire la justesse du film. Puis, je passe à Quai d’Orsay où j’entends Hubert Védrine me dire : « On n’a jamais décrit le quai d’Orsay avec une telle justesse ».
« Ce sont trois mondes que je ne connaissais absolument pas ! Je ne connaissais rien de ces univers. Un de mes plaisirs est de découvrir, d’apprendre et de me plonger physiquement dedans, en travaillant pour comprendre. »
Respect du son
Un jour, lors du tournage de La princesse, mon ingénieur du son vient me dire pendant une scène : « J’entends des cloches de vaches très fort ». Je me dis : « Est-ce que les vaches avaient des cloches au XVIe siècle ? » Question difficile ! On appelle mon conseiller qui nous dit « Oui, bien sûr, car certaines de ces cloches pouvaient être utilisées par les paysans pour avertir quand il y avait une attaque ou une intrusion d’une bande de brigands. Là, on se servait de la cloche de la vache. »
« Les troupeaux étaient très petits avec peu de vaches, très peu de bétail. Donc cela ne peut pas être un son de cloche très compact où on a l’impression qu’il y a beaucoup de vaches C’est impossible ! Il a donc fallu écarter les vaches et les repousser à 500 mètres pour qu’elles sonnent moins fort. C’est quelque chose que personne ne remarquera, mais moi je sais qu’on a un son de cloche dans le lointain qui est juste.
« Pour moi, c’est ma drogue de pouvoir répondre à ce genre de question. Et ce n’est pas seulement par souci de naturalisme, c’est par souci d’avoir une dramaturgie intéressante, parce que ce genre de trouvaille modifie la façon de jouer des acteurs, cela modifie le dialogue, et peut modifier la lumière, l’éclairage, donc modifier la mise en scène et cela va aider à la dramaturgie, l’assouplir, l’enraciner. Mais tout cela est totalement passé sous silence. Ça, c’est le sort d’un film souvent mal regardé, ou d’une manière trop superficielle ! Mais le film tient le coup et il survit à tout cela ! »
Le choix d’une équipe qui vous soutienne
« Au début, je ne savais rien. Parce que, ce que l’on apprend est théorique. La première chose que j’ai apprise, c’est de m’entourer d’une équipe qui me soutienne. Le choix des gens qui travaillent avec vous est primordial. Cela a commencé par les scénaristes. J’ai revu beaucoup d’anciens films, et j’ai travaillé avec beaucoup de cinéastes contemporains comme attaché de presse, avec Granier-Deferre, Deray, Sautet, etc. J’avais vu les problèmes qu’ils pouvaient avoir avec leurs scénaristes qui étaient souvent extrêmement pris car ils faisaient plusieurs films en même temps.
« Je me suis dit, si eux, ils n’y arrivent pas, moi qui arrive avec un premier film, ils me livreront une première version du scénario et après débrouille-toi ! Je me suis dit, il faut que je prenne des gens qui sont passés de mode, qui seront disponibles et qui voudront m’épater. Donc, j’ai été revoir des tas de films de ces scénaristes et j’ai retenu Maurice Aubergé qui avait travaillé beaucoup avec Becker et dont les dialogues de La vérité sur bébé Donge me semblaient épatants ; le dialogue était juste, inventif, parfois pas naturaliste, mais littéraire et intéressant.
« Après j’ai fait la même chose avec les autres techniciens. J’avais vu tellement de films où les metteurs en scène étaient abandonnés par leurs équipes, avec des techniciens formidables, mais qui n’étaient pas des gens qui venaient aider, qui montaient au créneau. Je me suis dit, il faut que j’aie quelqu’un qui soit passionné et qui me soutienne, qui ne lâche pas le coup si par hasard il y a un gros conflit avec le producteur ou un acteur ; il faut quelqu’un qui soit avec moi.
« Vraiment, j’ai vu dans ma carrière des chefs op. formidables ! Mais si Alain Delon élevait la voix, le chef op. partait, ce n’était pas son problème, il s’en lavait les mains ! Moi, je ne veux pas de ça, je veux quelqu’un qui m’aide et j’avais vu le travail de Pierre-William Glenn dans des films, et en plus il avait voulu que je juge son mémoire de maîtrise qui était : « Psychanalyse et freudisme dans la série B américaine »… quelque chose comme cela. Je me suis dit, je vais prendre quelqu’un comme ça. »
Pierre-William Glenn, mon formidable soutien
Ce que je dois à Pierre-William Glenn est énorme ! Au-delà de me soutenir dans le choix des cadres, des plans, des idées, des images, il m’a donné confiance. Je vais juste raconter un détail. Mon premier assistant était assez bourru, assez radical et j’ai eu du mal avec lui sur L’horloger de Saint-Paul ; il était assez cassant. Moi, je prenais des décisions très rapides.
« Il y avait une scène dans le parc entre Rochefort et Noiret qui s’est passée d’une façon tellement miraculeuse que j’ai dit : « Coupez, on la tire, c’est celle-là et on n’en fait pas une deuxième. » Et il me dit : « Tu vas découper maintenant », et je dis : « Non. » J’entends mon assistant qui me dit : « C’est ton film » d’un ton catastrophé et là c’est dur pour un metteur en scène. C’est votre premier film, vous êtes en train de douter là-dessus et là Glenn s’approche et me dit : « C’est toi qui as raison, ne lâche pas. »
« Il y avait une scène où je n’avais pas ce que je voulais et en même temps j’avais peur de dépasser le temps imparti. J’ai dit : « On arrête ! » Glenn vient et me dit : « On n’a pas encore trouvé un système pour mettre dans un film un sous-titre, cette scène n’est pas totalement réussie parce qu’on n’a pas eu assez de temps pour la tourner. Donc si tu veux qu’elle soit réussie, assure-toi qu’elle le soit et on oublie pour le dépassement. »
« Il était tout le temps comme cela. J’étais catastrophé par les premiers rushes. Il m’a dit : « Il y a deux choses dont il faut se méfier au cinéma, c’est l’enthousiasme au rush et la dépression après les rushes. Ce sont les deux choses qu’il faut mettre en doute ! Il ne faut jamais d’enthousiasme et ne jamais être déprimé. Attends que les plans se montent les uns avec les autres, attends de voir comment ils marchent et tu verras ! »
« Il avait entièrement raison car les scènes, une fois montées après deux jours de tournage, marchent impeccablement une fois qu’on les a mixées. Il faut avoir des gens qui soient mieux que des techniciens, qui soient des gens qui vous appuient, qui vous aident !
« Sur La mort en direct, dans une bagarre qui opposait Romy à Harvey Keytel, il dépassait largement son rôle de chef op. Il s’occupait de Romy, il a pu organiser une rencontre avec Harvey et Romy pour qu’ils puissent s’arranger. Et cela n’a pas de prix d’avoir des gens comme ça, des gens qui vont épauler votre passion !
« Dans le livre de Jean Aurenche, La suite à l’écran, on peut lire que « la première qualité chez un metteur en scène, c’est d’arriver à communiquer à tous ses collaborateurs, son enthousiasme et sa passion, et à créer chez ses collaborateurs l’envie de l’épater ». Il dit : « les meilleures scènes que j’ai écrites, je les ai écrites pour épater P. Bost ou B. Tavernier, c’est là où j’ai réussi mes scènes, quand je voulais les épater ». Ça, c’est formidable de créer chez ses collaborateurs, quels qu’ils soient, d’acteur à mixeur, en passant par ingénieur du son, l’envie d’épater ! »
FILMOGRAPHIE DE BERTRAND TAVERNIER
L’Horloger de Saint-Paul (1973),
Que la fête commence (1974),
Le Juge et l’assassin (1976),
Des enfants gâtés (1977),
La mort en direct (1980)
Une semaine de vacances (1980)
Coup de torchon (1981)
Mississipi Blues (1983)
Un dimanche à la campagne (1984)
Les mois d’avril sont meurtriers (1986)
Autour de minuit (1986)
La Passion Béatrice (1987)
La vie et rien d’autre (1988)
Daddy nostalgie (1990)
Contre l’oubli (1991)
La guerre sans nom (1992)
L627 (1992)
La Fille de d’Artagnan (1994)
L’Appât (1995)
The Making of an Englishman (1995)
Capitaine Conan (1996)
De l’autre côté du périph (1997)
Ça commence aujourd’hui (1998)
Laissez-passer (2002)
Holy Lola (2009)
Dans la brume électrique (2009)
La Princesse de Montpensier (2010)
Quai d’Orsay (2013)
Voyage à travers le cinéma français (2016), avec une suite de huit heures qui sera diffusée sur France 5 en 2018.